No products in the cart.
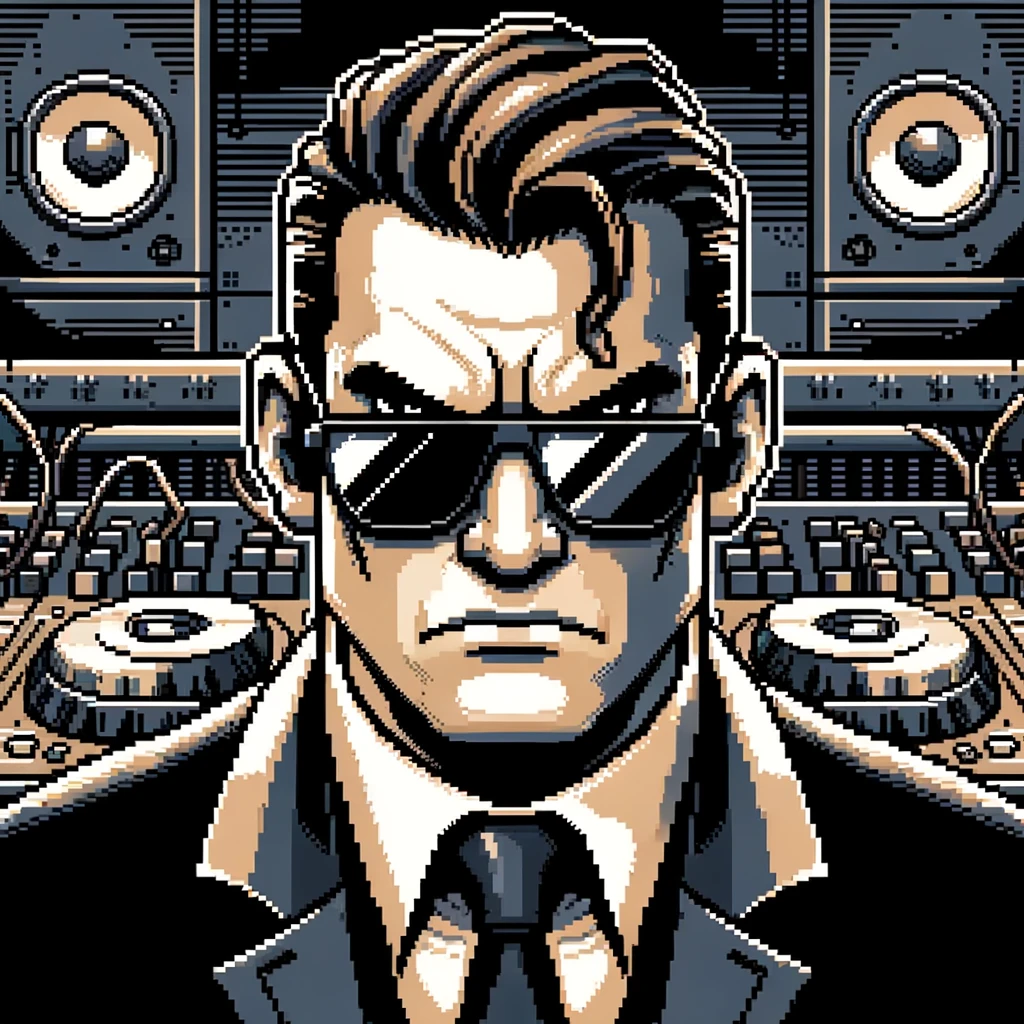
Reclaim the Door: Pourquoi la techno a besoin d’un nouveau gatekeeping
La musique électronique pèse désormais près de 13 milliards de dollars.
Si l’argent n’est pas un gros mot, il soulève des questions sur comment la techno a changé de nature. Elle est devenue un spectacle que l’on consomme, pas un moment que l’on vit.
Les clubs ressemblent à des vitrines, les festivals à des entreprises, les DJs à des produits. On lit partout que l’underground, lui, se dissout dans le marketing.
Vraiment ?
Pendant longtemps, on a cru qu’il fallait ouvrir les portes à toutes et à tous. Mais aujourd’hui, il faut admettre que la porte doit être gardée à nouveau. Pas pour exclure, mais pour protéger. Le mot « gatekeeping » a mauvaise réputation, pourtant il désigne ici un acte de soin : celui de maintenir une culture vivante, exigeante, et fidèle à ses valeurs fondatrices.
La techno n’a pas été inventée dans les bureaux d’une marque ni dans un VIP. Elle est née dans la marge, de la rencontre entre les communautés noires, queer, ouvrières, ou chez les nerds de machines et de tech. Des gens invisibles qui ont fait de la nuit un refuge et de la musique un langage. La fête, dans son essence, n’était pas une échappatoire, mais un acte de résistance. Une façon d’habiter un monde qui ne voulait pas de nous.
Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est le contraire. Une scène qui cherche à plaire. Une industrie qui capitalise sur les esthétiques de la transgression tout en vidant leur sens. Les soirées sponsorisées se succèdent, les influenceurs s’y affichent, les mêmes têtes d’affiche tournent d’un pays à l’autre, payées des dizaines de milliers d’euros pour reproduire un set identique. La plupart ne jouent plus mais elles performent. Les médias spécialisés, étranglés économiquement, troquent leur liberté éditoriale contre des partenariats. Les clubs qui survivent doivent séduire, les artistes doivent vendre, et le public doit payer toujours plus cher pour moins d’âme.
Dans ce paysage aseptisé, la hard techno est devenue le symbole de la dérive. Sa montée en puissance aurait pu être une bonne nouvelle : un retour à la radicalité, à la violence du son, à une esthétique brute. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.
Lors de la dernière Paris Electronic Week, une conférence sur la scène hard techno a révélé son aveuglement collectif. Quand le sujet du racisme et de la présence visible de l’extrême droite dans les soirées a été évoqué, le silence s’est abattu sur la salle. Les artistes présents ont botté en touche, certains affirmant que “c’était un problème français”, d’autres lançant des « stop the hate » pour noyer le débat. Une phrase anodine, mais lourde de sens : « tout le monde est bienvenu ».
Sauf que non, justement. Quand « tout le monde » est bienvenu, cela inclut ceux qui rendent d’autres personnes en danger. Quand des symboles néonazis circulent dans les clubs, quand des minorités arrêtent de venir parce qu’elles ne se sentent plus en sécurité, le refus de se positionner devient une trahison.
Une vidéo de ce débat devait sortir. Elle ne sortira probablement jamais. Pourtant, les enregistrements existent, et ils finiront par parler car ce malaise dit tout d’une scène qui préfère ne rien perdre, quitte à tout trahir.
Cette neutralité n’est pas innocente car elle est le produit d’un système. Dans une économie où chaque post, chaque set, chaque mot a un coût, se taire devient rentable. Se dire « apolitique » est un luxe que seuls ceux à l’abri peuvent s’offrir. Et pendant qu’ils gardent leurs deals et leurs cachets, les communautés à l’origine de cette musique continuent de se battre pour exister.
Le danger est installé, un milieu qui a fait de la résistance sa langue maternelle préfère désormais la neutralité à la solidarité. Une scène née contre le racisme, l’homophobie et le sexisme s’accommode aujourd’hui du silence, tant que les chiffres tiennent.
Une nouvelle figure a fait son apparition dans les clubs, celle de l’influenceur de la nuit. Ces visages familiers d’Instagram ou de TikTok qui ne viennent plus vraiment pour danser, mais pour exister. Leur présence s’achète à coups d’invitations gratuites, de verres offerts et de posts calibrés . Pour beaucoup, la fête n’est plus un espace de liberté, mais un plateau de tournage. Cette économie du paraître a introduit un biais massif dans la critique : puisque ces créateurs de contenu dépendent de leur accès gratuit pour exister, ils ne disent presque jamais rien de négatif. Tout devient « incroyable », “inoubliable”, « inclusif » « authentique », même quand le dancefloor est vide. En réduisant la nuit à un produit d’appel, ils participent à effacer la valeur symbolique et politique des clubs. Le dancefloor n’a jamais été conçu pour générer du contenu, il est un lieu d’expression, pas de capture. Y transformer la fête en fond visuel, c’est trahir son essence. Ceux qui n’en connaissent pas l’histoire et n’en respectent pas les codes confondent l’extase avec la visibilité. Et c’est précisément cette confusion qui tue la culture.
Mais pendant que le haut de la pyramide se gave (littéralement), les bases s’agitent. Des clubs allemands réintroduisent des politiques de porte strictes, non pour filtrer les classes sociales, mais pour préserver le respect et la sécurité. Des collectifs refusent les téléphones à l’intérieur, d’autres n’affichent plus leurs line-ups pour redonner à la fête son mystère. À Cologne, à Bruxelles, à Lyon, des soirées queer réinventent la fête comme espace politique. À Dortmund, le Tresor West expérimente des community nights gratuites, financées par une caisse solidaire, pour rendre la fête accessible à ceux qui n’en ont plus les moyens. En Ouganda, Sénégal, Tunisie ou au Maroc, des soirées s’organisent comme on le faisait si bien avant. Ce sont de petits gestes, mais ils redessinent les contours d’une scène plus juste.
Le gatekeeping, dans ce contexte, n’est pas un retour en arrière. C’est une réaction nécessaire. Refuser de laisser les téléphones envahir les dancefloors, refuser la complaisance, refuser l’entrée à ceux qui viennent consommer sans comprendre, ce n’est pas exclure, c’est sauver. Parce que la fête, celle de la techno/house, n’est pas faite pour tout le monde, et c’est ce qui la rend précieuse.
Il faut la rendre à celles et ceux qui la vivent vraiment, que ce soient les DJs de l’ombre, les bénévoles, les danseur-euses, les technicien-nes, les militantes, les publics curieux. Ceux qui savent encore pourquoi cette musique existe. Ceux qui n’ont jamais confondu liberté et indifférence.
Le public, lui, a un rôle immense à jouer. Tant qu’il acceptera de payer des tickets à 120 euros pour deux jours, tant qu’il applaudirait des line-ups identiques, les sets de 45min, les fleurs de Lys et les drapeaux 88, tant qu’il fermera les yeux sur les dérives, il entretiendra le système qu’il critique. Le pouvoir de transformation n’est pas entre les mains des marques, mais entre celles de celles et ceux qui dansent.
Revenir à l’esprit originel de la fête, c’est pas penser que tout était mieux avant, c’est refuser qu’elle soit un produit. C’est comprendre que la liberté ne se vend pas mais qu’elle se cultive.
Et, encore une fois, l’existence de plusieurs scènes est tout à fait viable. Si tu viens pour écouter du son Tiktok ou radio, personne n’a le droit de te juger. Le mépris de classe par les goûts musicaux n’a pas sa place dans ce milieu. Chacun, chacune, prend son temps pour évoluer musicalement.
Le renouveau viendra des marges, encore une fois. De ces artistes queer qui en ont marre d’être entouré·es de gens qui nient leur existence, de ces collectifs dont la diversité ne s’arrête pas aux visuels promotionnels, mais se vit dans les équipes, les valeurs et les décisions, et de ces militantes qui refusent de fermer les yeux sur les agresseurs.Avec, on l’espère, l’aide de médias encore indépendants qui continueront de parler sans peur. Le futur de la techno sera communautaire, ou ne sera pas.
Garder la porte, c’est rappeler que la fête n’a jamais été faite pour être filmée, mais pour être vécue. C’est dire non aux spectateurs et oui aux participants. C’est refuser la neutralité et choisir le sens. Parce qu’au fond, ce qu’on défend n’est pas un style de musique, mais une idée du monde, un endroit où le corps, le son et la liberté se confondent.
Et si la techno doit redevenir un refuge, il faudra bien que quelqu’un, à l’entrée, ait le courage de dire : Pas cette fois.

